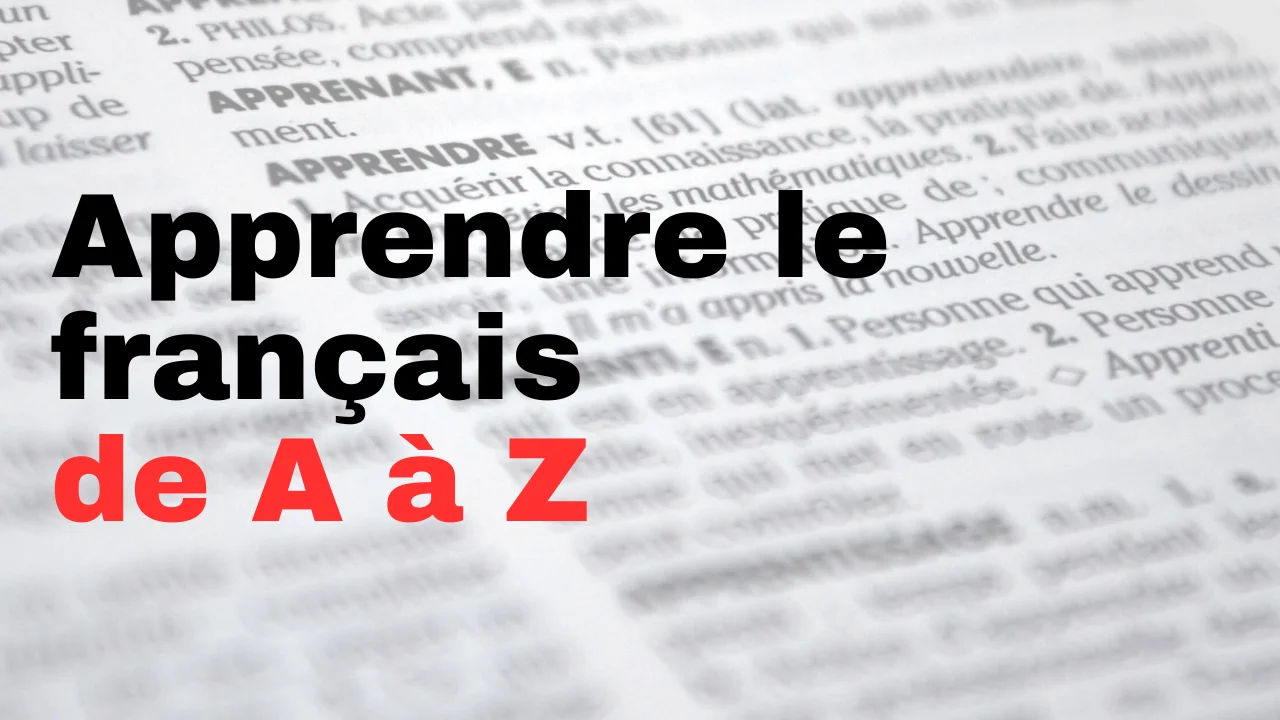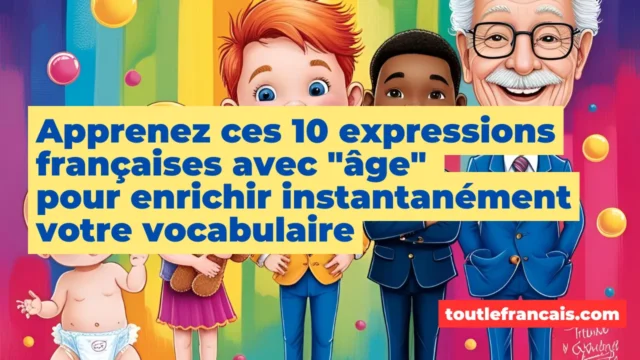Chaque année, le dictionnaire Le Petit Robert s’enrichit de nouveaux mots, expressions et sens qui reflètent l’évolution de notre langue et de notre société.

L’édition 2026, qui vient d’être annoncée, ne fait pas exception avec environ 150 nouveautés linguistiques. Mais parmi toutes ces additions, quel est le mot qui mérite le plus notre attention ?
Le français expliqué simplement, avec des exercices interactifs
Accédez à des leçons claires, des explications détaillées et des exercices interactifs pour progresser efficacement en français, à votre rythme.
La « dinguerie » en tête du classement
Selon le palmarès dévoilé par les Éditions Le Robert, c’est le mot « dinguerie » qui occupe la première place du Top 10 des nouveaux entrants. Mais attention, il ne s’agit pas d’un terme totalement nouveau ! C’est plutôt un mot qui connaît une seconde vie, avec une signification qui a considérablement évolué.
Apparu initialement dans les années 1920, « dinguerie » désignait à l’origine le caractère d’une personne ou d’un comportement jugé dingue, avec une connotation généralement négative. Après être resté dans l’ombre pendant des décennies, ce terme a été adopté par la jeune génération à la fin des années 2010 et largement popularisé sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, une « dinguerie » peut désigner quelque chose d’incroyable, d’extraordinaire, que ce soit en bien ou en mal. Cette évolution sémantique rappelle celle du mot « tuerie » qui, au sens figuré, qualifie désormais quelque chose d’excellent. Vous pourriez ainsi entendre : « Ce gâteau, c’est une dinguerie ! » pour exprimer votre admiration culinaire.
D’autres nouveautés linguistiques qui marquent notre époque
Le Top 10 des nouveaux mots du Petit Robert 2026 reflète également les préoccupations et évolutions de notre société :
- « Hypertrucage » (ou « deepfake ») : ce terme québécois désigne les manipulations audiovisuelles permettant de créer des contenus truqués ultra-réalistes.
- « Surcyclage » : traduction de l’anglais « upcycling », il s’agit de transformer des objets usagés en produits de plus grande valeur.
- « Mpox » : nouvelle désignation de la maladie auparavant connue sous le nom de « variole du singe ».
- « Microagression » : propos ou acte d’apparence banale mais perçu comme discriminant par la personne visée.
- « Kamishibaï » : technique japonaise de narration utilisant des planches illustrées dans un théâtre portatif.
- « Hallucination » : ce mot ancien prend un nouveau sens dans le contexte de l’intelligence artificielle, désignant une réponse fausse mais d’apparence vraisemblable produite par une IA.
- « Zaatar » : mélange d’épices et d’herbes séchées originaire du Moyen-Orient.
- « Pelleteux de nuages » : expression québécoise désignant une personne qui échafaude des projets irréalisables.
- « Mon gâté » / « Ma gâtée » : terme d’affection marseillais popularisé par le rap français.
Une langue en perpétuelle évolution
Ce palmarès nous rappelle que la langue française est vivante et en constante mutation. Des néologismes liés aux nouvelles technologies côtoient des expressions régionales qui gagnent en popularité, des termes liés au développement durable ou encore des mots venus d’ailleurs qui enrichissent notre vocabulaire.
Comme le montre l’exemple de « dinguerie », même les définitions des mots existants ne sont pas figées et continuent d’évoluer avec l’usage. Le dictionnaire se doit donc de suivre ces évolutions pour rester le reflet fidèle de la langue telle qu’elle est parlée aujourd’hui.
Pour découvrir l’intégralité des 150 nouveaux mots et expressions qui font leur entrée dans le Petit Robert 2026, n’hésitez pas à consulter le site officiel des Éditions Le Robert.
Et vous, quel est votre mot préféré parmi ces nouveaux venus ? La « dinguerie », le « surcyclage » ou peut-être le poétique « pelleteux de nuages » ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire !